
Les drapeaux algériens flottent à Alger, le 16 avril 2025. © Fateh Guidoum, AP
Déjà en froid avec ses plus proches voisins et la France, l'Algérie voit sa diplomatie mise à rude épreuve après l'adoption d'une résolution de l'ONU favorable au Maroc sur le Sahara occidental où Alger soutient les indépendantistes du Polisario.
Sous l'impulsion des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a estimé qu'une "véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait représenter la solution la plus réalisable" pour résoudre ce conflit vieux de 50 ans.
Malgré l'hostilité de l'Algérie, qui n'a pas voté, la résolution a été adoptée vendredi 31 octobre par 11 voix. La Chine, la Russie et le Pakistan, principaux alliés d'Alger, se sont abstenus. À New York, on attend désormais le plan marocain "développé et actualisé".
Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a minimisé la portée de l'événement, arguant que "le Maroc n'a pas réussi à imposer le projet d''autonomie' comme solution exclusive à la question sahraouie".
Pour autant, "la résolution de vendredi dernier constitue un revers pour la diplomatie algérienne", constate Sabina Henneberg, experte au Washington Institute, relevant également les "nombreux défis" auxquels la diplomatie algérienne est confrontée. Et de citer non seulement "les répercussions des efforts agressifs du Maroc autour de la question du Sahara occidental, qui commencent désormais à porter leurs fruits", mais encore "l'empiètement russe au Sahel qui a mis à mal les relations entre Moscou et Alger".
Expertise en matière de lutte anti-terroriste
Le Sahara occidental, colonie espagnole jusqu'en 1975, est contrôlé en majeure partie par le Maroc, et considéré comme un territoire non autonome par les Nations unies. Un conflit y oppose Rabat aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie.
Marquée historiquement par une forme de non-alignement, l'Algérie a connu un long repli diplomatique lorsque le président Abdelaziz Bouteflika a été victime d'un AVC en 2013. Alger disparait alors largement de la scène internationale, régionale, arabe, africaine.
Le plus grand pays d'Afrique, situé dans une zone riche en hydrocarbures et frontalier de pays où la sécurité est chaotique (Mali, Niger, Libye), s'est ensuite attaché à reprendre sa place dans le concert des nations en défendant une stratégie de souveraineté forte. Outre ses richesses pétrolières, l'Algérie, qui a connu une décennie de guerre civile avec des attentats, est reconnu pour son expertise en matière de lutte anti-terroriste.
"L'Algérie a signalé ces dernières années sa volonté de jouer un rôle plus actif sur la scène mondiale, notamment à travers son élection au Conseil de sécurité des Nations unies" comme membre non-permanent, souligne Sabina Henneberg. Elle a aussi entrepris des "petites démarches pour approfondir sa relation bilatérale avec les États-Unis", dit-elle, citant un cabinet de lobbying à Washington.
À la faveur de la guerre en Ukraine, Alger a pu se poser comme alternative pour la fourniture de gaz naturel et de pétrole pour des Européens cherchant à réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Il a tissé des liens solides notamment avec l'Italie.
Sur le continent africain, l'Algérie, a signé en février avec le Nigeria et le Niger des accords pour accélérer la réalisation du projet du gazoduc transsaharien. Pour autant, "l'Algérie enregistre des limites en matière de politique étrangère", note Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
L'une des illustrations est l'échec de la candidature algérienne au club des Brics à l'été 2023. "Le président Abdelmadjid Tebboune avait reçu une fin de non-recevoir presque humiliante de la Russie", allié historique qui fournit à l'Algérie la majeure partie de son armement, rappelle Hasni Abidi.
"Plusieurs rouages"
"Il y a une évolution majeure dans les relations internationales et l'Algérie donne des signes d'essoufflement", poursuit-il, estimant qu'il y a urgence pour Alger "à réajuster les objectifs de sa politique étrangère". Par contraste, le Maroc, avec lequel l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques, a réintégré l'Union africaine, et impose sa force économique sur le continent.
"L'Algérie ne peut pas se permettre de rester en désaccord constant avec la France", ancienne puissance coloniale, dit-il, en référence à une crise inédite cristallisée par le soutien de la France au plan marocain sur le Sahara occidental. Il faut aussi qu'elle pacifie les relations avec son environnement régional, juge-t-il.
Sur ce front, la tâche est ardue alors que l'Algérie partage plus de 1 300 km de frontière avec le Mali, confronté depuis 2012 aux violences de groupes jihadistes et où transitent divers trafics (drogue, armes, migrants). Fin mars, Alger a abattu un drone de l'armée malienne au motif qu'il avait violé son espace aérien.
Le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso avaient rappelé leurs ambassadeurs en retour, accusant Alger d'avoir mené une "action hostile préméditée". Quelques semaines plus tard, les trois pays annonçaient vouloir "accélérer" l'initiative proposée par le Maroc pour favoriser l'accès de leurs pays à l'Atlantique.
Ces tensions ont des ramifications jusqu'au Moyen-Orient, Alger accusant les Émirats Arabes Unis de financer ou de fournir des armes à la junte au pouvoir au Mali. Le gouvernement algérien reproche en outre aux Émirats une politique régionale jugée interventionniste, notamment en Libye, où ceux-ci soutiennent des acteurs comme le général Khalifa Haftar opposés à ceux soutenus par Alger.
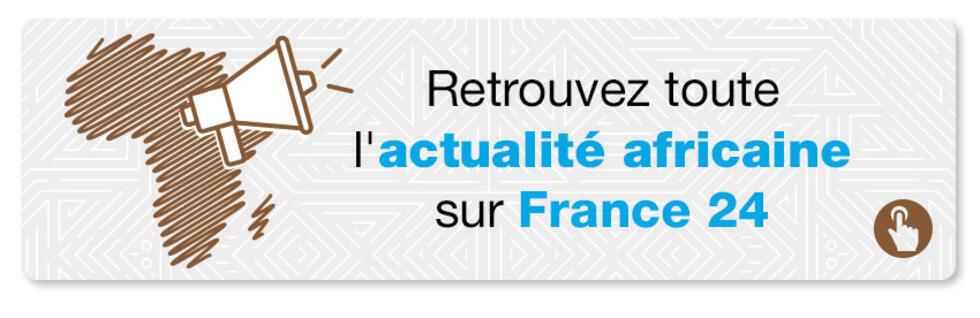
Outre un contexte international chahuté, la politique étrangère algérienne – domaine réservé du président – doit composer avec des prises de décision lentes "car elles passent par plusieurs rouages", explique Hasni Abidi. "Le fonctionnement du système politique algérien est très complexe puisque l'armée, l'état-major de l'armée, les services de renseignement sont parties prenantes dans la prise de décision", dit-il.
Des acteurs qui pèsent dans les tensions avec Paris, qui attend des gestes pour ses deux ressortissants, l'écrivain Boualem Sansal (également de nationalité algérienne) et le journaliste Christophe Gleizes. Leur détention est jugée "arbitraire".
Avec AFP
