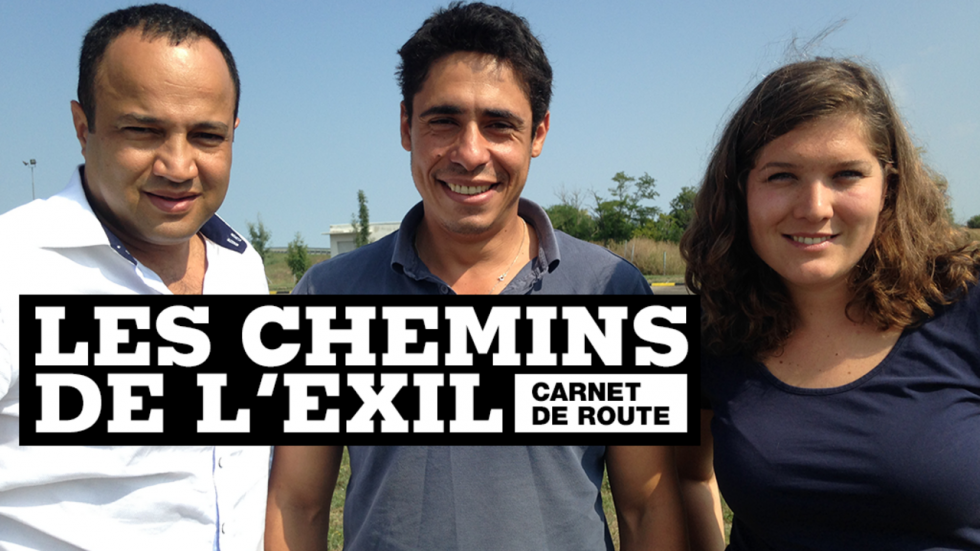
De l’est de la Grèce à l’extrême nord de la France, des milliers de migrants, fuyant la Syrie, l'Irak ou encore l'Afghanistan, empruntent la route des Balkans. Karim Hakiki, reporter de France 24, livre ses impressions dans son carnet de route.
Ils arrivent par milliers. Après avoir bravé les dangers d’une traversée de la Méditerranée, ils débarquent sur les côtes européennes, notamment grecques, avec le ferme espoir d'une vie meilleure, loin des violences. Quels sont leurs désirs et leurs regrets ? Comment vivent-ils, seuls ou en famille, l’exil et la précarité ? Qui sont ceux que l’Europe nomme communément "les migrants" ? De Thessalonique, en Grèce, jusqu’à Calais, dernière étape avant le Royaume-Uni, une équipe de France 24 suit la route empruntée par des dizaines de milliers de personnes, jetées sur les routes par la guerre et les persécutions. Au-delà de cette actualité, France 24 vous propose quotidiennement de découvrir le regard que porte notre reporter Karim Hakiki sur ce périple.
Samedi 5 septembre, sur la route reliant Budapest (Hongrie) à Vienne (Autriche)
"Hier, on a quitté Budapest. On a passé la soirée avec les migrants le long de l’autoroute, en direction de Vienne. On doit trouver des femmes pour faire un sujet et c’est assez compliqué. On raconte une histoire avec des gens qui viennent de Syrie, qui ont une culture particulière. Il y a des femmes mais on a plus de facilité à parler aux hommes. Depuis le début, on veut leur donner la parole mais c’est très difficile parce qu’elles sont souvent en retrait.
On a tourné un reportage avec une Kurde qui s’appelle Amira. Elle nous a raconté son histoire. Lorsqu’on fait du reportage, on n’a pas de recul. La rédaction t’appelle et te fait remarquer qu’il n’y a pas que des hommes et des enfants parmi les migrants. Sur le terrain, on a tendance à aller vers la facilité parce que les hommes parlent plus facilement. C’est une culture assez machiste. Lorsqu’on a parlé à Amira, il y avait des hommes autour qui voulaient prendre la parole mais elle ne s’est pas laissé faire. Elle a réussi à nous parler. J’ai essayé de la convaincre en lui faisant du charme et ça a marché. Et puis, on a la chance d’avoir une femme parmi nous et ça facilite les choses. Fernande est donc allée lui parler et passer du temps avec elle avant que nous commencions à tourner.
Les migrants viennent assez facilement nous parler, mais dès que l’on sort du factuel et que l’on veut leur faire raconter leur propre histoire, ça devient plus compliqué. D’une part, ils ont peur des représailles. Par exemple, le mari d’Amira est un ancien militaire et tant qu’ils ne sont pas arrivés à bon port, il pense mettre ses proches en danger. D’autre part, et cela compte beaucoup dans la culture arabe, c’est qu’ils ont honte. Ceux qui ont quitté la Syrie à l’Irak, souvent, ne sont pas les plus à plaindre. Il s’agit de personnes appartenant à la classe moyenne et ils ne veulent pas montrer dans quelles conditions ils vivent désormais. Souvent, ils nous demandent de ne pas les filmer en disant : "Je n’ai plus de dignité, je ne veux pas montrer ça". Et puis nous ne passons pas beaucoup de temps avec eux, c’est ce qui est compliqué. Il faut qu’ils mettent leur vie sur la table très rapidement. Généralement, l’émotion et les larmes montent très vite. Hommes ou femmes.
"On ne peut pas rester insensibles"
Hier, il nous est arrivé quelque chose de très difficile et on ne savait pas quoi faire. On était au bord de l’autoroute et on a vu une famille qui était en plein milieu. Ils avaient perdu le groupe avec lequel ils avançaient car leur voiture de location était tombée en panne. Il était 23 h et les enfants étaient en pleurs. L’un d’eux est allé voir Adel et lui a dit : "S’il te plaît, trouve nous une voiture". On est journalistes, on s’est demandé quoi faire. Notre voiture était pleine mais on ne pouvait pas les laisser au milieu de nulle part. La mère de famille tremblait comme une feuille parce qu’elle avait peur d’être attrapée par la police. Elle est venue se cacher derrière notre véhicule. On s’est alors demandé quel était notre rôle. On est témoin : on ne peut pas intervenir mais on ne peut pas rester insensibles et ne rien faire. Bien entendu, on ne pouvait pas les transporter. Pour les aider, nous leur avons donné des informations et nous les avons rassurés.
En Serbie, Adel m’a raconté qu’un homme était venu le voir en lui disant que sa femme était malade. Il lui a trouvé une application sur le téléphone pour traduire en serbe le mot "malade". Il lui a fait répéter phonétiquement le mot, puis l’homme est allé voir un policier. Alors qu’ils ne sont pas réputés être les plus tendres, quand il a dit au policier dans sa propre langue "Ma femme est malade", son visage s’est décomposé, il ne pouvait que l’aider. Les aider comme on peut, c'est notre manière ànous de dire qu’on ne se sert pas d’eux, qu’on ne se contente pas de les suivre. De plus, on connaît mieux les pays européens qu’eux. On leur donne aussi des informations pour savoir où prendre un bus, où passer la frontière. Ça leur fait un bien fou. Et à nous aussi. On en parle beaucoup entre nous. On n'est pas des monstres".
