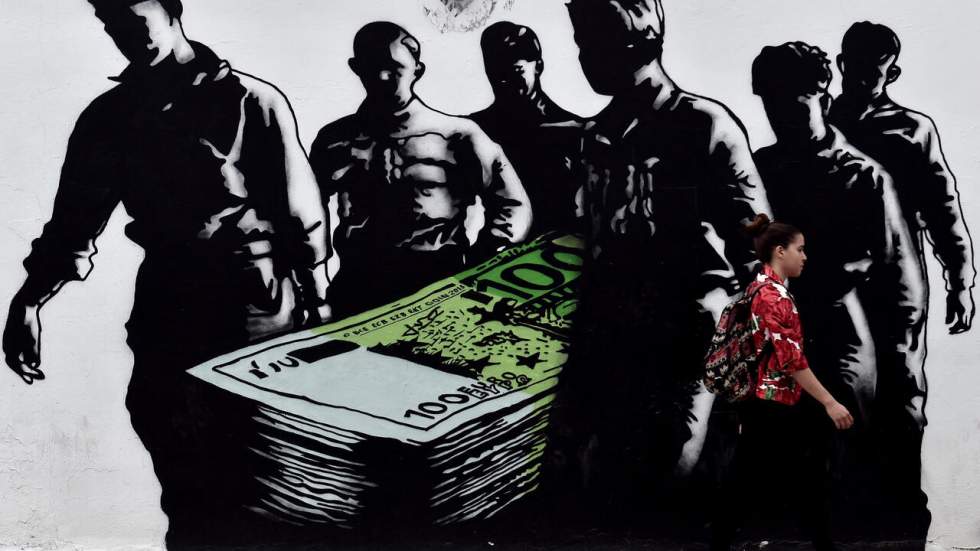
Banque centrale européenne, France, Allemagne, Commission européenne : ils ont tous un rôle particulier à jouer dans la crise grecque post-référendum. Qui fait quoi ? Les explications de France 24.
Difficile de s’y retrouver dans l’Europe post-référendum grec, tant les signaux contradictoires se succèdent. Pour y voir plus clair dans ce second acte de la crise grecque, version 2015, France 24 a préparé un récapitulatif des rôles que chacun des partenaires de la Grèce peut jouer et des enjeux pour les uns et les autres.
La Banque centrale européenne (BCE). L’institution financière de Francfort tient l’avenir immédiat de la Grèce entre ses mains. Les banques grecques ont survécu jusqu’à présent grâce à une ligne de crédit exceptionnelle de la BCE.
Les banquiers centraux européens ont décidé, lundi, de continuer à soutenir le secteur bancaire grec. L’enjeu était crucial : après la victoire du “non” au référendum, le Premier ministre Alexis Tsipras a fait de la remise en état de marche des banques sa priorité numéro 1.
Mais sans l’aide de la BCE, les banques grecques n'auraient pas tenu longtemps. Il ne leur restait plus que 500 millions d’euros de réserve environ. Si l’institution financière européenne avait décidé de couper complètement l’aide aux établissements grecs, l’hypothèse d'un “grexit”, c'est à dire d'une sortie de la Grèce de la zone euro, aurait pu prendre corps. Pour sauver les banques de la faillite sans la BCE, la banque centrale grecque aurait dû accorder un financement d’urgence aux banque, ce qui l’obligeait à imprimer elle-même de la monnaie. Or elle ne peut pas le faire tant que la Grèce est dans la zone euro.
Dans tous les cas, la BCE ne peut pas décider toute seule de condamner Athènes à choisir entre la faillite de ses banques et la sortie de l’euro. Elle avait déjà indiqué, lors de la crise bancaire irlandaise de novembre 2010, qu’elle ne prendrait pas ce genre de responsabilité. C’est pourquoi il faut encore attendre le sommet des chefs d’État mardi pour trancher.
La France. L’Allemagne est très remontée contre la Grèce, elle-même très remontée contre l'Allemagne. Et la France se trouve entre les deux. Son rôle pourrait se révéler décisif : réussir à amener les deux adversaires du jour autour de la table des négociations en faisant table rase des provocations du passé.
C’était tout l’enjeu de la réunion à l’Élysée, lundi soir, entre François Hollande et la chancelière Angela Merkel. Le président français a tenté de rétablir le dialogue entre les deux parties. Pour ménager les deux camps, la diplomatie française a dû trouver un ton qui n’irrite pas Athènes tout en semblant être sur la même longueur d’onde ou presque qu’Angela Merkel. "Dans cette Europe, il y a de la place pour la solidarité (...) mais il y a aussi la responsabilité", a ainsi déclaré François Hollande.
Une manœuvre diplomatique qu’avait déjà essayée de faire le ministre français des Finances, Michel Sapin. Il avait déclaré, lundi sur Europe 1, que le "non" au référendum ne "remettait pas en cause" les négociations, mais que "le fil du dialogue était très tenu". Il s’était montré ouvert à un "allègement" de la charge de la dette, mais à condition que la Grèce fasse des "propositions sérieuses et solides".
L’Allemagne. La marge de manœuvre d’Angela Merkel est faible. Sur le front intérieur, elle ne peut pas ignorer que la quasi-totalité de la classe politique et une partie de l’opinion publique ne veut plus entendre parler d’aider la Grèce. Mais si elle reste intransigeante et hâte la sortie de la Grèce de la zone euro, elle restera dans les annales comme la chancelière du "grexit".
Et ce n'est certainement pas le legs que veut laisser cette dirigeante qui s’est, depuis 2010, opposée plus d’une fois aux faucons de son parti - comme le ministre des Finances Wolfgang Schaüble - pour aider Athènes à rester dans la zone euro.
Au terme de sa réunion avec François Hollande, la chancelière est restée assez ferme, tout en indiquant que "la porte restait ouverte aux discussions". Elle a indiqué que les conditions pour de nouvelles "négociations" avec la Grèce n'étaient "pas réunies" et qu'il revenait au Premier ministre grec Alexis Tsipras de faire des propositions "précises".
Un peu plus tôt lundi, le vice-chancelier et patron des sociaux démocrates du SPD Sigmar Gabriel avait adopté un ton intransigeant. Il ne s'était pas privé de taper sur la Grèce, en affirmant qu’Alexis Tsipras avait “coupé les derniers ponts” entre son pays et l’UE et qu’il jugeait “difficilement imaginables” de nouvelles négociations.
Même la démission du turbulent ministre grec des Finances Yanis Varoufakis, perçu comme un geste d'apaisement de la part d’Alexis Tsipras, n’a pas calmé Berlin. Le gouvernement a fait savoir que le problème “n’était pas une question de personne, mais de conviction”.
Le Fonds monétaire international (FMI). Les Grecs et les autres européens n'ont pas intérêt à ce que le FMI revienne trop rapidement mettre son grain de sel dans la situation post-référendum.
L'institution présidée par Christine Lagarde a eu ces derniers temps un comportement imprévisible, qui a pris de court à la fois Bruxelles et Athènes. Une part des responsables européens lui en veut encore d'avoir publié, à deux jours du référendum, une analyse faisant d'un allègement de la dette un élément central de tout sauvetage de la Grèce, assure le "Financial Times". Ce document avait été repris par Athènes pour justifier le "non" au référendum car il contredisait les autres créanciers qui ne voulait pas entendre parler des renégociations de la dette.
Mais le FMI n’est pas non plus l’ami d’Alexis Tsipras, qui le sait bien. La Grèce a fait défaut, mardi 30 juin, vis-à-vis de l’institution internationale qui a entamé une procédure pour retard de paiement. Un processus visant à savoir si Athènes va continuer à faire partie des instances du FMI ou non et comment faire pour que le pays finisse par rembourser sa dette. Le gouvernement grec peut donc s’attendre à des nouvelles pressions pour réformer davantage les retraites ou augmenter la TVA, deux des chevaux de bataille du FMI dans le dossier grec.
La commission européenne. Jean-Claude Juncker en est resté sans voix, lundi 6 juillet. Le président de la commission européenne avait activement fait campagne pour le “oui” au référendum grec. Le résultat de dimanche est donc une défaite personnelle pour celui qui voulait incarner le dossier grec au niveau européen. Il a assuré qu’il s’exprimerait mardi 7 juillet sur la question.
Mais en attendant, certains se demandent si au lieu de renforcer l’influence de la commission au sein des institutions européennes, la crise grecque n’a pas miné sa crédibilité. Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe (les ministres des Finances de la zone euro), confronté lundi à une question sur l’opportunité d’une démission de Jean-Claude Juncker après le désaveu grec, a préféré… ne pas répondre.
Avec l’appel, lancé dimanche par Angela Merkel, à un sommet des chefs d’État mardi sur la question grecque, le dossier semble échapper des mains de la commission européenne. Dans ce contexte, Jean-Claude Juncker apparaît comme la principale victime politique du référendum. Sa réplique au vote grec est donc très attendue pour savoir s'il sera capable de reprendre la main.
