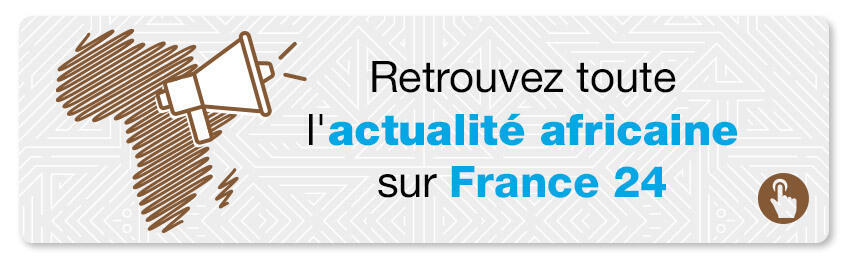Les discussions à Niamey ont été "franches", affirment les États-Unis. Un peu trop au goût des militaires nigériens au pouvoir. Samedi 16 mars, quelques jours après le départ d’une délégation américaine venue s’entretenir avec les autorités de transitions, le porte-parole du régime a annoncé la rupture "avec effet immédiat" de l’accord militaire entre les deux pays, régissant la présence des forces américaines au Niger.
Lors de son allocution télévisée, le colonel Amadou Abdramane a assené une série de critiques acerbes contre Washington, fustigeant la présence militaire "illégale" des États-Unis, fruit d’un accord "imposé" au pays, la "condescendance" de la cheffe de la délégation, la secrétaire d'État adjointe aux Affaires africaines Molly Phee, ainsi que la volonté américaine "de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires".
Cette annonce de rupture intervient après huit mois de difficiles négociations entre les autorités nigériennes, arrivées au pouvoir le 26 juillet 2023 en renversant le président Mohamed Bazoum, et Washington à propos de la coopération militaire entre les deux pays ainsi que le chemin vers les élections.
Les États-Unis avaient déployé d’importants efforts diplomatiques, espérant éviter le même sort que la France, poussée vers la sortie et qui a achevé en décembre le retrait de ses 1 500 soldats. Ils avaient opté pour une approche plus conciliante vis-à-vis de la junte que celle de Paris et des alliés régionaux du président déchu, espérant ainsi trouver un terrain d’entente avec les nouvelles autorités. En vain.
Réticence à parler de coup d’État
Cette différence d’approche était apparue en premier lieu sur le plan sémantique. Alors que Paris et la Cédéao (Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest) avaient vigoureusement dénoncé le putsch et appelé au rétablissement immédiat de Mohamed Bazoum dans ses fonctions, les États-Unis qualifiaient encore, le 8 août 2023, la situation de "tentative de prise de pouvoir par les militaires".
Une approche pour le moins prudente qui s’explique d’abord par le cadre légal qui régit l’aide octroyée par Washington aux pays tiers. La loi sur les crédits annuels du département d’État restreint de manière très stricte l’assistance fournie à un pays "dont le chef de gouvernement dûment élu est déposé par un coup d'État militaire".
Or Washington a alloué ces dernières années plusieurs centaines de millions de dollars au pays, via des programmes d’aide au développement, mais aussi pour renforcer le partenariat militaire avec Niamey, considéré jusqu’alors comme le pilier de la lutte anti-terroriste américaine dans la région.
Symbole de cet ancrage, l’ouverture en 2019 de la base militaire américaine 201 à Agadez, le principal pôle américain de renseignement et de surveillance au Sahel. Cette base, équipée de drones et dont on estime qu’elle aurait couté à Washington 100 millions de dollars, abrite la plupart des quelque 1 100 soldats américains, toujours présents dans le pays.
Changement de braquet
Conscients qu’ils ne pourraient maintenir longtemps une position ambiguë, les États-Unis avaient enclenché des négociations dans l’optique du retour rapide d’un gouvernement civil au pouvoir. Sans succès.
Dépêché début août à Niamey, l’émissaire américaine Victoria Nuland avait alors reconnu des discussions "assez difficiles" avec les nouvelles autorités. Elle n’avait pu voir ni le chef des putschistes, Abdourahamane Tiani, ni le président déchu, Mohamed Bazoum.
Le 10 octobre, les États-Unis avaient durci le ton, reconnaissant pour la première fois le "coup d’État" à Niamey et suspendant, du même coup, la majeure partie de leurs programmes de soutien au pays, dont l’assistance et la formation des forces nigériennes, pour un montant avoisinant les 500 millions de dollars.
Malgré ce net changement de braquet, Washington ne comptait pas pour autant renoncer au partenariat avec Niamey. Aucun des deux pays n’évoquait alors le départ des forces américaines du pays.
En décembre, suite à une première visite de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Phee, dans la capitale nigérienne, les États-Unis avaient même annoncé qu’ils souhaitaient reprendre leur coopération en matière de sécurité et de développement avec le Niger, à condition que le pays prenne des mesures pour rétablir la démocratie.
"Ingérence" américaine
Lors de son allocution samedi 16 mars, le colonel Amadou Abdramane a réaffirmé la "ferme volonté" du gouvernement de transition d’organiser "dans les meilleurs délais le retour à une vie constitutionnelle normale". Ni les pressions de la Cédéao ni celle des États-Unis n’ont permis d’obtenir un quelconque calendrier quant à l’organisation d’élections.
Mais c’est un autre point des discussions qui semble avoir provoqué la rupture des relations : la question des partenaires diplomatiques et stratégiques du Niger.
Car outre les négociations sur la préservation de la base militaire américaine à Agadez, les États-Unis, très inquiets de la progression russe en Afrique et en particulier de la milice Wagner, tentaient depuis des mois de convaincre le Niger de ne pas suivre l’exemple malien. Le rapprochement en septembre du pays avec le Mali et le Burkina, tous deux dirigés par des militaires, au sein de l’Alliance des États du Sahel, avait été perçu d’un mauvais œil par Washington, tout comme la rupture en décembre par le Niger de deux accords de défense avec l’UE, alors même que les autorités de transition accueillaient une délégation russe.
"Les militaires au pouvoir et leurs soutiens semblaient apprécier la position américaine lorsqu’elle avait appelé à privilégier les chemins pacifiques face au projet d’intervention militaire de la Cédéao" analyse un chercheur spécialiste du Niger, sous couvert d’anonymat. "Mais visiblement les États-Unis n’ont pas compris que Niamey, comme Bamako et Ouagadougou, est désormais dans une logique de refus de tout diktat et de tout alignement".
Le porte-parole de la junte a reproché samedi à Molly Phee des "allégations mensongères" concernant un accord secret sur l’uranium avec la République d’Iran. Il a par ailleurs défendu la coopération avec la Russie, décrite comme un "partenariat d'État à État" pour "acquérir le matériel nécessaire à la lutte contre le terrorisme".
Accord militaire déséquilibré ?
Enfin, Amadou Abdramane a fustigé le caractère "illégal" et "injuste" de l’accord de défense liant les deux pays. Une simple "note verbale", selon le porte-parole de la junte, "imposée unilatéralement" au Niger. Ce document, daté du 6 juillet 2012 et consultable sur le site du département d’État américain, est pourtant accompagné de courriers du ministère des Affaires étrangères nigérien, dirigé à l’époque par Mohamed Bazoum, qui manifeste son accord "sur l’ensemble du contenu du projet".
"Les militaires nigériens n’ont jamais été satisfaits de l’apport tactique des 1 100 soldats de la base américaine dont ils jugeaient l’appui en renseignement insuffisant", souligne l’expert. Mais le départ des forces américaines n’est pas sans risque car Niamey pourrait s’exposer à "des mesures de rétorsions économiques et politiques et se priver d’appui en formation et équipement", poursuit-il, rappelant que les avions C130 Hercules, utilisés par l’armée nigérienne pour le transport de troupes, sont des dons américains.
En réalité, "le contentieux ne porte pas sur la nature supposément déséquilibrée de l’accord de défense, car les soldats américains ont entraîné les forces nigériennes et ont participé à l’équipement des troupes", analyse le journaliste nigérien Seidik Abba. "Les États-Unis avaient choisi de rester en misant sur une diplomatie du dialogue et de la persuasion, à la fois sur la question démocratique et sur celle du choix des partenaires. Mais les autorités estiment qu’ils sont allés trop loin dans leur ingérence ce qui les expose aujourd’hui au même sort que la France. Reste maintenant à savoir si les États-Unis vont partir immédiatement ou bien faire de la résistance comme Paris", précise le journaliste, auteur du livre "Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger" (Éd. L'Harmattan, mars 2024).
En août 2023, la junte nigérienne avait réclamé le départ des forces françaises puis celui de l’ambassadeur de France à Niamey. Emmanuel Macron avait d’abord rejeté ces requêtes affirmant que seul le gouvernement élu du pays pouvait prendre de telles décisions. Fin septembre il avait finalement annoncé le départ des troupes ainsi que le rapatriement du diplomate français.
"Nous avons pris connaissance de la déclaration du CNSP (NDLR : Conseil national pour la sauvegarde de la patrie) au Niger" a réagit dimanche Matthew Miller, porte-parole du département d’État américain. "Nous sommes en contact avec le CNSP et nous fournirons d'autres mises à jour si nécessaire" a-t-il conclu dans un bref message sur le réseau social X.