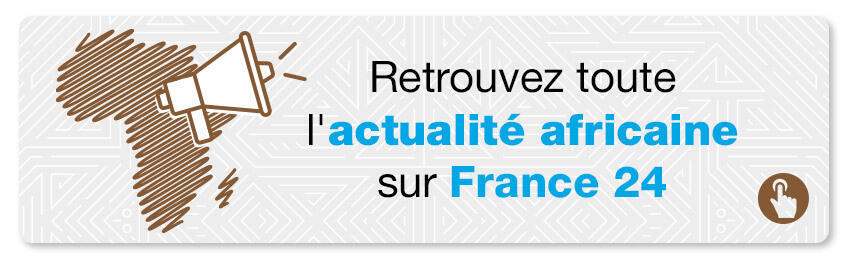Sa nomination symbolise le retour de l’État à Kidal après plus de dix années passées sous le joug des groupes armés. Mercredi 22 novembre, le gouvernement de transition a désigné le général El Hadj Ag Gamou, figure touarègue de l’armée malienne bien connue du public, au poste de gouverneur de la région.
Cette annonce intervient huit jours après la reprise par les forces armées maliennes – et les miliciens russes de Wagner – de cette région, contrôlée depuis 2012 par des groupes majoritairement touaregs, signataires de l’accord d’Alger, regroupés sous la bannière CSP-PSD (Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement).
Alors que l’avancée des militaires avait généré un exode de population craignant les affrontements et d’éventuelles exactions, les autorités de transition ont, depuis la reprise de la ville, appelé les locaux à rentrer chez eux, affirmant que les forces armées assureraient leur protection.
Victoire symbolique
Pour les autorités de transition maliennes, la reprise de Kidal est une victoire majeure à plus d’un titre.
Tout d’abord, elle marque un tournant décisif dans le conflit entre les militaires au pouvoir et ces groupes à majorité touarègue qui a éclaté, après des mois de tension, autour de la question du contrôle des bases de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali).
Alors que ces groupes voyaient déjà d’un mauvais œil les discours souverainistes des autorités de transition, l’annonce en juin du départ des Casques bleus, à la demande du pouvoir, et la volonté affichée de l’armée de prendre le contrôle des emprises de l’ONU dans le Nord, ont été perçues comme une déclaration de guerre.
Les autorités de transition estiment qu’il s’agit d’un pilier essentiel de la reconquête de l’intégrité territoriale. Mais pour le CSP-PSD, le contrôle des bases des Nations unies par l’armée est contraire à l’esprit de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, dit accord d’Alger, dont il est partie prenante. Signé en 2015, cet accord prévoyait notamment le désarmement de ces groupes, leur intégration dans l’administration ainsi qu’un élargissement des pouvoirs de cette région du Nord, appelée "Azawad" par les ex-rebelles.
La prise de Kidal, considérée comme leur fief, marque donc une victoire majeure pour l’État face à ces groupes, mais également vis-à-vis de l’opinion malienne et de la communauté internationale.
"C’est une façon d’effacer l’affront de 2012, lorsque la France, intervenue à la demande du Mali pour stopper l’avancée des groupes terroristes vers Bamako, avait refusé de laisser entrer l’armée à Kidal, affirmant redouter que des exactions ne soient commises", rappelle le Dr Mohamed Amara, sociologue et analyste sécuritaire malien. "L’armée veut montrer non seulement qu’elle est capable de reprendre le contrôle de son territoire mais aussi de se démarquer de cette mauvaise réputation sur la question des droits de l’Homme, qu’elle estime injustifiée. Ceci explique pourquoi elle est si sensible à ce type d’accusations et également pourquoi le retour des populations à Kidal est aujourd’hui un facteur clé."
Un général touareg pour tourner la page
Le 17 novembre, soit trois jours après l’annonce de la reprise de Kidal, le colonel-major Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, a publié un communiqué appelant les populations à rentrer chez elles, précisant que des dispositions avaient été prises pour "éviter tout amalgame".
"C’est un changement de ton très net pour les autorités, qui essaient désormais de calmer le jeu", analyse le journaliste malien Malick Konaté. "Jusqu’ici, elles affirmaient faire la guerre aux terroristes sans distinction entre les groupes liés à Al-Qaïda ou à l’État Islamique et le CSP-PSD, bien que signataire de l’Accord. Certains de ceux qui ont fui font partie du CSP-PSD, ou parfois le soutiennent. D’une certaine manière, Bamako les met au pied du mur en disant : 'Vous ne voulez pas être considérés comme terroristes ? Alors déposez les armes."
Pour appuyer cette nouvelle stratégie, les autorités de transition ont désigné mercredi le général El Hadj Ag Gamou comme nouveau gouverneur de Kidal. Cette figure de l’armée bien connue remplace le colonel Fodé Malick Sissoko, dont un enregistrement, prétendument favorable aux groupes rebelles, avait fuité quelques jours plus tôt sur les réseaux sociaux.
Annoncée par une figure locale membre du Conseil de transition, puis confirmée en Conseil des ministres, la nomination d'El Hadj Ag Gamou a donné lieu à de nombreux messages de félicitations parmi les soutiens de la junte, soulignant le patriotisme du général touareg qui, après avoir combattu un temps au sein de la rébellion, est devenu, depuis la fin des années 1990, un soutien indéfectible de l’État malien.
#Kidal : je tiens à exprimer au Général de division Alhaji Ag #Gamou mes plus sincères félicitations pour sa nomination en tant que gouverneur de la région de Kidal. Son dévouement exemplaire à l'armée et son service antérieur dans cette région éprouvée par 12 années de lutte… pic.twitter.com/BQSxtpttN2
— Moussa AG Acharatoumane (@Mossa_ag) November 22, 2023"El Hadj Ag Gamou a été choisi car c’est un homme de terrain qui connaît très bien la région", analyse Malick Konaté. "Cette nomination permet également d'affaiblir le CSP-PSD car le gouverneur fait lui aussi partie d’un groupe armé signataire de l’accord d’Alger, le Gatia (Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés). Or celui-ci soutient l’État central et ne souhaite pas une plus grande autonomie du Nord, contrairement au CSP-PSD."
Pour sa part, le Dr Mohamed Amara voit dans cette annonce un important aspect communautaire. "Iyad Ag Ghali, le chef du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda, et Alghabass Ag Intalla, le plus important chef rebelle touareg, sont tous deux issus de la communauté des Ifoghas. El Hadj Ag Gamou est quant à lui un Imghad, une communauté vassalisée par les Ifoghas, qui essaie de se défaire de cette position. Ce choix permet donc à l’État de créer un nouveau rapport de force communautaire dans la région pour asseoir son pouvoir. En soutenant une personnalité Imghad, il se pose en défenseur des faibles tout en appuyant son discours d’apaisement qui vise désormais à souligner que tous les Touaregs ne sont pas des rebelles."
Retour à la table des négociations ?
Pour l’heure, nul ne connaît les intentions des membres du CSP-PSD qui ont fui Kidal, abandonnant leur fief. S’il n’y a pas eu, depuis la reprise de la ville, d’affrontements rapportés entre les groupes touaregs et l’armée malienne, la guerre informationnelle bat son plein.
Après la "découverte d’un charnier" à Kidal, annoncée par l’armée et imputée aux groupes armés, ces derniers ont dénoncé par communiqué des "allégations", "évidemment montées de toutes pièces" pour "masquer les horribles massacres commis par le duo terroriste Wagner-FAMa (Forces armées maliennes)."
Si la situation demeure pour le moins tendue entre le gouvernement central et le CSP-PSD, la reprise de Kidal a été largement saluée au Mali. Plusieurs acteurs politiques en ont profité pour appeler à "renouer le dialogue" afin "d’instaurer un climat de paix et de confiance", comme le Parti pour la renaissance nationale (Parena).
"L’accord d’Alger est certes en état de veille mais il n’a pas été dénoncé officiellement, ni par les autorités, ni par le CSP-PSD", souligne le Dr Mohamed Amara. "Tout conflit armé finit toujours avec une signature de paix. Il est urgent de rouvrir les canaux de discussion, par exemple par le biais de l’Algérie qui, de par sa position géographique et son poids militaire dans la région, a un rôle prépondérant à jouer."
Malick Konaté estime, lui aussi, que le temps des négociations est venu. "La révision de l’accord d’Alger doit avoir lieu depuis des années. Elle avait déjà été évoquée lors du dialogue national à l’époque du président Ibrahim Boubacar Keïta et acceptée par plusieurs groupes. Au Mali, beaucoup estiment que cet accord a été imposé par la communauté internationale. Avec le départ de la France et de l’ONU, cet argument ne tient plus. Il s’agit désormais de discussions entre Maliens. Les négociations devraient donc être plus faciles."