
La Lune pourrait être la prochaine frontière pour le déploiement de l'énergie nucléaire. Mais probablement sous la forme de micro-réacteurs. © Studio graphique France Médias Monde
"C’est un petit isotope pour l’Homme, mais une grande fission nucléaire pour l’humanité." Telle pourrait être la prochaine devise de la conquête spatiale si l'on en croit les déclarations du directeur par intérim de la Nasa. Sean Duffy, également ministre américain du Transport, a fait de l’installation d’un réacteur nucléaire sur la Lune la priorité de l’agence spatiale américaine, a expliqué le site Politico, mardi 4 août.
L'ancien présentateur de Fox News a même envoyé une directive à ses équipes jeudi 31 juillet pour mettre l’accent sur cet objectif qu’il a qualifié de "seconde course à l’espace" après celle qui a vu, le 20 juillet 1969, un Américain poser un pied sur la Lune. Bien avant un cosmonaute soviétique.
Arriver le premier avant la Chine et la Russie
Sean Duffy a fixé une date butoir : 2029 pour faire décoller le premier réacteur nucléaire vers la Lune, précise le New York Times. À temps pour damer le pion spatial à la Chine et à la Russie qui ont ensemble l’ambition d’établir leur propre générateur nucléaire sur la Lune au début des années 2030.
En mai, les deux principaux rivaux de Washington ont signé un protocole d’accord pour œuvrer de concert afin de faire de ce réacteur la source d’énergie pour la future base lunaire "internationale" qu'ils dirigent conjointement.
Pour afficher ce contenu YouTube, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.
Accepter Gérer mes choixUne extension de votre navigateur semble bloquer le chargement du lecteur vidéo. Pour pouvoir regarder ce contenu, vous devez la désactiver ou la désinstaller.
Réessayer
Cette "course" au réacteur nucléaire spatial est, en effet, liée aux différents programmes de bases lunaires, dans le cadre de la mission américaine Artemis ou du projet chapeauté par Moscou et Pékin. "Les futures missions lunaires vont nécessiter bien plus d’énergie que celles des années 1970. Avec la perspective d’y établir des bases permanentes, il sera nécessaire de pouvoir générer, par exemple, sa propre eau et de l’oxygène", explique Simon Middleburgh, chercheur à Institut pour l’avenir du nucléaire à l’Université de Bangor, au Pays de Galles.
Quelle source d’énergie serait alors la mieux adaptée pour accompagner l’aventure lunaire ? "Il y a eu beaucoup d’expérimentations à l’âge d’or de l’exploration spatiale dans les années 1960 et 1970 et déjà à l’époque, il était question de nucléaire. Il y a donc des recherches depuis des décennies, même si pour le grand public, l’idée d’un réacteur nucléaire sur la Lune peut sembler nouvelle", souligne Carlo Carrelli, spécialiste de l’énergie nucléaire à l’Agence nationale italienne pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable.
Des microréacteurs pour éclairer la nuit lunaire
"Naturellement, on penserait d’abord au photovoltaïque, qui est la source d’énergie la plus utilisée dans l’espace avec les panneaux solaires. Mais sur la Lune, il y a un problème spécifique lié à la durée de la nuit lunaire", note Ian Whittaker, astrophysicien à l’université de Nottingham. En effet, une nuit lunaire s'étire sur 14 nuits terriennes. Autrement dit, il faudrait une quantité considérable de batteries pour stocker l’énergie emmagasinée afin d’en avoir en continu pendant la longue nuit lunaire. Ce serait très coûteux et difficile à transporter sur place.
L’avantage du nucléaire réside aussi dans l’efficacité de cette source d’énergie. "C’est très dense, ce qui signifie qu’un réacteur de la taille environ d’une voiture citadine pourrait permettre, en théorie, de procurer de l’énergie à une base lunaire pour environ six ans sans avoir besoin d’être rechargé", affirme Simon Middleburgh.

Et la taille compte. Plus c’est petit, mieux ce sera pour la Lune. En effet, "la centrale nucléaire typique construite sur Terre est énorme, pèse très lourd et fournit énormément d’énergie. C’est non seulement impossible à déployer sur la Lune car il faudrait transporter des milliers de tonnes d’acier et de béton, mais ce serait en outre une déperdition d’énergie énorme pour des bases qui, du moins au début, ne seront pas très grandes", juge Carlo Carrelli, qui travaille au projet italien Selene (Système d’alimentation lunaire utilisant l’énergie nucléaire).
"Pour l’instant, la recherche se concentre sur ce qu’on appelle des microréacteurs qui fournissent des kilowatts d’énergie et non pas des gigawatts, comme c’est le cas avec les centrales sur Terre. De telles structures peuvent être transportées à bord de fusées", assure Ian Whittaker.
Pas de Tchernobyl lunaire, mais d’autres risques
Cependant, même s’il n’est pas question de transporter la centrale de Fessenheim ou Flamanville sur la Lune, ce devrait tout de même être une opération coûteuse. D’abord, parce qu’il est difficile d’estimer précisément combien de microréacteurs il faudra déployer. En effet, même si un seul pourrait suffire, il est essentiel d’avoir des réacteurs de secours au cas où. Impossible d’imaginer une base lunaire où il n’y aurait aucune solution alternative si les lumières venaient à s’éteindre en cas de panne d’un réacteur, notent les experts interrogés par France 24. Établir ces microréacteurs sur la Lune devrait donc coûter plusieurs milliards de dollars, entre le prix du voyage et celui de la fabrication de ces sources d’énergie.
Et ce n’est qu’un problème parmi d’autres. "Il y aura des défis inédits liés, notamment, à l’absence d’atmosphère sur la Lune. Sur Terre, la dissipation de la chaleur créée par la fission nucléaire est possible en partie grâce à l’existence de l’atmosphère terrestre. Il faut donc prendre cet aspect en compte pour trouver des moyens alternatifs pour refroidir les réacteurs", constate Simon Middleburgh.
Pour afficher ce contenu YouTube, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.
Accepter Gérer mes choixUne extension de votre navigateur semble bloquer le chargement du lecteur vidéo. Pour pouvoir regarder ce contenu, vous devez la désactiver ou la désinstaller.
Réessayer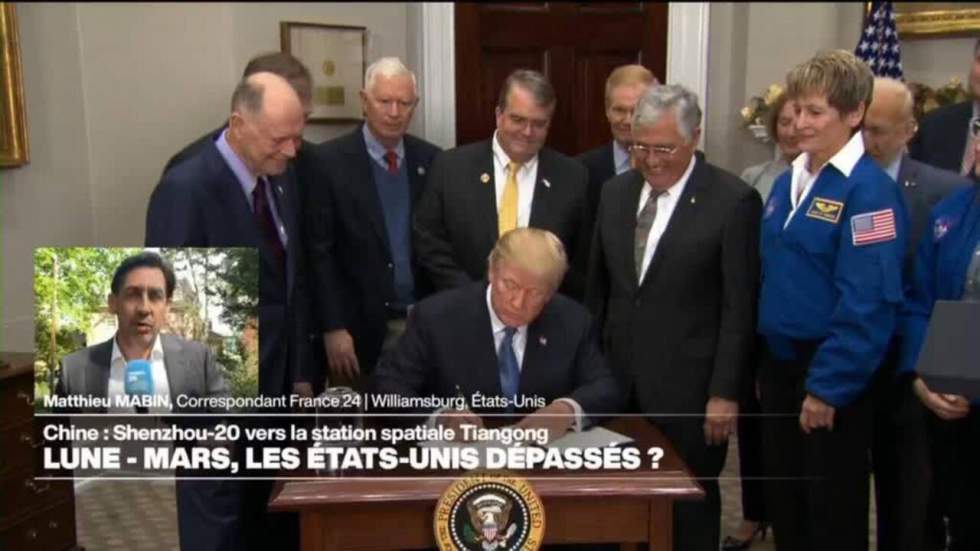
Même chose avec les lois de la gravité. "Sur la Lune, il n’y a quasiment pas de gravité, et des phénomènes comme l’ébullition ne se déroulent pas comme sur Terre, ce qui complique également le processus de dissipation de chaleur", ajoute Simon Middleburgh, chercheur à Institut pour l’avenir du nucléaire, au Pays de Galles.
Quid aussi du risque d’explosion ? Un Tchernobyl sur la Lune relèverait d’un scénario catastrophe digne d’un film de science-fiction. Mais les experts interrogés minimisent ce risque, en partie parce que le manque d’oxygène réduit le risque de certaines réactions chimiques qui peuvent entraîner ce genre de catastrophes.
Il n’empêche que ce sont autant de questions à étudier de près, même si les "microréacteurs nécessaires sont plutôt faciles et rapides à construire", souligne Carlo Carrelli.
Les colons de l’espace ?
Dans ce contexte, l’objectif fixé par le patron de la Nasa de lancer un réacteur nucléaire sur la Lune avant 2030 peut sembler excessivement optimiste. "Mais pas totalement irréaliste, même si le début des années 2030 me semblent plus crédibles", estime Carlo Carrelli, spécialiste de l’énergie nucléaire.
La volonté de Washington d’en faire une "course spatiale" à gagner au plus vite peut se comprendre. "L’aspect géopolitique est presque plus important que le défi technologique de construire et d’établir ces réacteurs sur la Lune", souligne Ian Whittaker. En effet, il risque d’y avoir une réelle prime au premier arrivé.
"Tout le monde veut être le plus rapide car il n’y a actuellement pas de lois ou de traités sur la colonisation de la Lune", affirme Ian Whittaker, astrophysicien à l’université de Nottingham. Pour ce spécialiste, "c’est un peu comme à l’époque de la colonisation : celui qui s’installait le premier pouvait affirmer que cette terre lui appartenait".
Sur la Lune, les réacteurs nucléaires pourraient être utilisés pour gagner du terrain. "L’idée serait d’installer en premier les réacteurs et d’affirmer qu’il est nécessaire de construire la base lunaire à proximité et, ainsi, de préempter la région alentour", détaille Ian Whittaker. Et il n’existe aucune règle à ce jour pour contester ce genre de comportement colonisateur.
"Bien sûr, en tant que scientifique, on ne peut qu’espérer que la communauté internationale collabore comme avec la Station spatiale internationale", veut espérer Simon Middleburgh. Pas sûr, cependant, qu’en l’état actuel des relations entre les États-Unis, la Chine et la Russie, l’esprit soit à la coopération.
