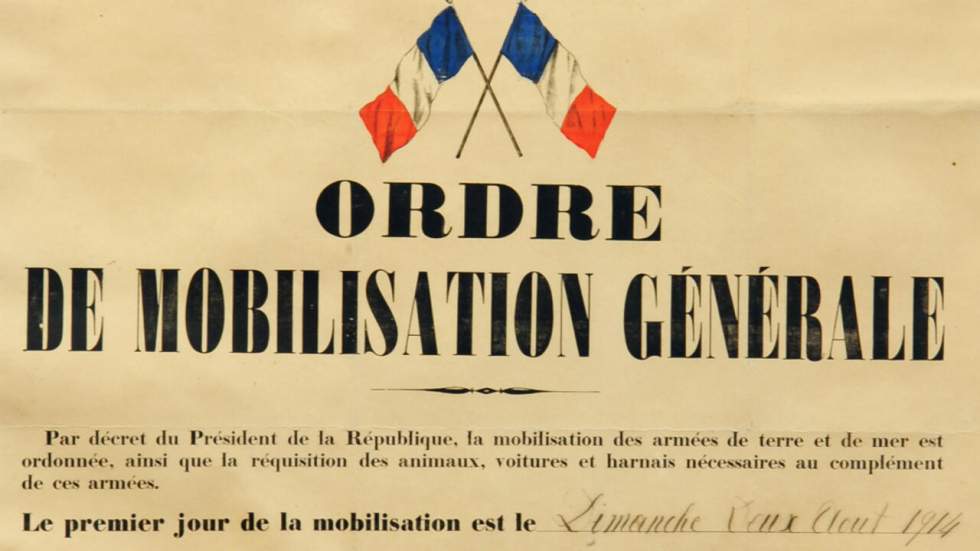
Le 30 juillet 1914, la Russie et l'Autriche-Hongrie décrétaient la mobilisation générale. Comment s'est enclenché l'engrenage qui a plongé le monde dans le chaos ? Analyse de l'Australien Christopher Clark, auteur du best-seller "Les Somnambules".
Depuis sa parution en 2013, "Les Somnambules" de l’Australien Christopher Clark est devenu un best-seller. Ce professeur de l’Université de Cambridge plonge le lecteur dans les dessous des alliances géopolitiques qui ont mené au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pour mieux comprendre ce conflit qui entraîna la mort de 10 millions de soldats, toutes nations confondues, il décrit les rouages et les motivations des grandes puissances européennes avant et pendant l’été 1914. Il replace notamment au cœur de sa démonstration la crise des Balkans. Cent ans après le début de la Grande Guerre, l’historien revient pour FRANCE 24 sur ces pourparlers diplomatiques qui plongèrent le monde dans le chaos.
FRANCE 24 : Pourquoi avez-vous décidé de vous intéresser au déclenchement de la Grande Guerre ?
Christopher Clark : Il me semblait que notre regard du XXIe siècle offrait de nouvelles perspectives, car notre monde, d’une certaine manière, ressemble de plus en plus à celui de 1914. Nous ne vivons plus dans le monde stable et bipolaire de la Guerre froide. Nous vivons dans un monde imprévisible et multipolaire. Et, bien qu’il y ait des milliers de livres sur cette question, la grande majorité ne se base que sur un seul pays. Enfin, cette guerre est un thème central dans l’histoire de l’Australie, c’est le premier conflit auquel ce pays a participé en tant que nation indépendante et cela a toujours fait partie de ma vie.
F24 : Pourquoi avez-vous choisi de répondre à la question "comment" la guerre s’est déclenchée plutôt que "pourquoi" ?
C.C. : La question "pourquoi" nous conduit automatiquement vers des causes abstraites : le nationalisme, l’impérialisme, la diffusion du darwinisme social etc. Si on regarde la guerre de cette façon, on pense facilement qu’elle était inévitable. Et "pourquoi" a souvent signifié "qui". Cette approche se focalise sur l’identification d’un coupable ou d’un pays responsable. Le problème de cette démarche est qu’elle nous incite à étudier les actions et les motivations d’un seul État plutôt que d’examiner comment les interactions complexes d’une pluralité de grandes puissances ont entraîné cette guerre.
F24 : Selon vous, aucun gouvernement ni aucune personnalité ne doit porter une responsabilité particulière dans le déclenchement de la guerre ?
C.C. : C’est la question qui a généré le plus d’émotion dans ce débat. Je pense que toutes les grandes puissances continentales étaient prêtes à se lancer dans une guerre majeure pour protéger leurs propres intérêts. Si l’on estime que les causes immédiates de la guerre ne débutent qu’avec l’assassinat de Sarajevo, il est alors normal de s’intéresser plus particulièrement aux garanties que l’Allemagne apporte à l’Autriche. Mais si l’on s’intéresse au fait que les Balkans ont été l’étincelle qui a conduit à la guerre, il faut regarder plus attentivement la politique russe et française entre 1912 et 1914.
F24 : Certains disent que dans votre livre, vous pointez pourtant du doigt la responsabilité de la Serbie...
C.C. : C’est absolument faux. Accuser la Serbie du déclenchement de la guerre est absurde, mon ouvrage essaye d’intégrer l’histoire de la Serbie dans cette analyse. Sinon, il est impossible de voir comment les assassinats de Sarajevo ont entrainé la réaction des Autrichiens. Mais cela ne signifie pas que je blâme ce pays. Les Serbes ne voulaient rien de plus que ce que les Italiens et les Allemands avaient déjà réussi à faire au XIXe siècle, c'est-à-dire créer un État-nation élargi, si nécessaire par la force.
F24 : Votre livre a été beaucoup critiqué en Serbie. Qu’avez-vous pensé de ces réactions ?
C.C. : Je suis heureux de voir que mon livre a suscité le débat en Serbie, car c’est un pays ou le débat historique peut faire beaucoup de bien. La vieille garde des historiens nationalistes a déversé un torrent d’injures et quelques figures politiques de l’ère de Milosevic les ont également rejoints. Mais je suis optimiste. Je suis confiant dans le fait que les Serbes vont développer une relation équilibrée et critique par rapport à leur passé, de la même manière qu’en France ou en Allemagne. Je viens d’un pays où nous devons vivre avec le fait que nos ancêtres ont détruit une large part de la population indigène. Les Australiens acceptent aujourd’hui cette histoire comme une partie de leur passé.
F24 : Vous vous intéressez également au rôle de la Russie, qui avait de nombreux intérêts à voir débuter cette guerre...
C.C. : Chaque partie avait des intérêts à suivre. Je ne pense pas que la Russie avait souhaité ou planifié ce conflit à l’avance. Mais elle poursuivait une politique à haut-risque dans les Balkans, une politique qui a aggravé le danger d’un conflit majeur. Les Russes l’ont fait pour des raisons complexes, dans lesquelles les affinités émotives et les intérêts géostratégiques étaient entremêlés.
F24 : Vous expliquez que la France et la Grande-Bretagne n’ont pas vraiment essayé de modérer les ambitions de la Russie et d'empêcher la guerre...
C.C. : Oui, la France a même fait le contraire. La politique de Raymond Poincaré [président de la République française en 1914, NDLR] n’avait pas pour but, au départ, de stopper l’escalade mais de préserver l’intégrité de l’alliance franco-russe et l’entente avec la Grande-Bretagne, ce qui était beaucoup plus difficile. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il souhaitait ou qu’il avait planifié la guerre. Empêcher le conflit, n’était juste pas sa priorité. C’était une politique très intelligente, mais qui comportait beaucoup de risques.
F24 : Pourquoi avoir choisi le titre "Les Somnambules" ?
C.C. : C’est un terme très beau et suggestif. Bien entendu, il s’agit d’une métaphore. Je l’ai utilisé pour capter la vision étroite de ces principaux acteurs et montrer le déséquilibre entre les politiques choisies par ces individus, qui semblaient alors très rationnelles selon les informations disponibles, et le comportement du système dans son ensemble, qui était tout sauf rationnel.
