
Les dirigeants africains célèbrent samedi à Addis Abeba cinquante ans d'efforts vers l'unité du continent, en formulant l'espoir que l'actuel envol économique de l'Afrique permette enfin de réaliser les rêves nés de l'indépendance.
Le 25 mai 1963, 32 chefs d'États africains créaient l'Organisation de l'unité africaine (OUA), ancêtre de l'Union africaine (UA), autour de l'idéal du panafricanisme. Cinquante ans plus tard, les dirigeants des 54 États membres de l'UA célèbrent la fondation de cette organisation, qui peine toujours à faire de l'Afrique un continent uni.
Le premier siège de l’OUA (Organisation de l’unité africaine) était à l’époque, en 1963, le bâtiment le plus haut d’Addis Abeba, petite capitale impériale, nichée à 2400 mètres d’altitude…
it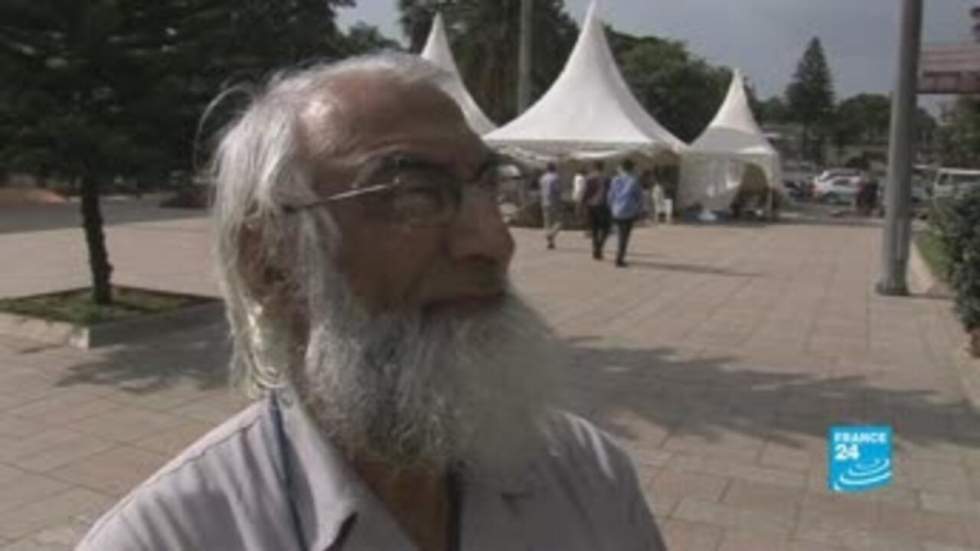
L’immeuble de béton dominait une prison, où l’empereur Hailé Sélassié, puis ensuite Mengistu Hailé Mariam, "le Négus rouge" (équivalent de roi, ndlr), enfermaient leurs opposants, sans que cela n’émeuvent les diplomates africains.
En 1963 les "pères fondateurs" signent "la charte de l’Unité africaine" fondée sur la base d’un principe : la non ingérence dans les affaires intérieures des états membres. L’intangibilité des frontières héritées de la colonisation est réaffirmée.
Des présidents "révolutionnaires" ou "réactionnaires"
Mais au-delà des envolées lyriques sur l’unité d’un continent sorti des ténèbres de la colonisation, deux camps s’affrontent déjà : d’un côté les partisans du fédéralisme et de l’unité de l’Afrique emmenés par le Ghanéen Kwame Nkrumah, le chantre du panafricanisme, et de l’autre, les tenants de l’Afrique des États, autour du Sénégalais Léopold Sédar Senghor et de l’Ivoirien Félix Houphouët Boigny. La jeune organisation sera pendant deux décennies le champ clos des rivalités entre grandes puissances.
La persistance de l’apartheid en Afrique du sud et le combat pour la libération des dernières colonies portugaises d’Afrique ont accentué les clivages. Les présidents "révolutionnaires" et les présidents "réactionnaires", s’affrontent à coups de discours enflammés sous le regard de leurs parrains russes et américains, paralysant ainsi cette organisation créée pour accélérer l’unité du continent.
La guerre du Biafra, le retrait du Maroc consécutif à l’adhésion de la République arabe sahraoui seront autant d’exemples de crises qui ont paralysé le fonctionnement de l’organisation.
Naissance de l'UA en 2002
Il faudra attendre la chute du Mur de Berlin, et ses conséquences politiques en Afrique, pour voir la vieille OUA, paralysée et inaudible, se transformer, en 2002, en une nouvelle organisation, l’Union africaine. Le modèle de l’UA est calqué sur celui de l’Union européenne avec une commission et un Parlement dont le rôle politique est réaffirmé.
Les ambitions affichées se heurteront aux projets du colonel Kadhafi qui pèsera de tout son poids pour faire de l’Union africaine un instrument au service des ses rêves mégalomaniaques. Le guide libyen a, pendant plus d’une décennie, imposé ses objectifs, n’hésitant pas à brandir la menace de la déstabilisation à ceux qui n’adhéraient pas à ses ambitions. Malgré la pression libyenne, le conseil de paix et de sécurité de l’UA, calqué sur le Conseil de sécurité des Nations unies, réussit malgré tout à condamner les coups d’État.
C’est aussi cet organe qui est à l’origine du déploiement de plusieurs milliers de soldats africains en somalie, essentiellement des Ougandais et des Burundais. Ces casques blancs de l’Amisom ont réussi à bouter, hors de la capitale somalienne Mogadiscio, les islamistes, les fameux "shebabs".
L'UA et le Mali
Si l’UA peut, à juste titre, brandir l’exemple somalien comme illustration de la volonté des Africains de régler eux-mêmes leurs problèmes, l’organisation a brillé par son impuissance face au défi djihadiste dans la bande sahélo-saharienne. Au Mali, l’Union africaine n’a joué que les spectateurs face, dans un premier temps, à la Cédéao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), et ensuite face aux Nations unies qui ont désormais la haute main sur l’avenir de ce pays grâce au déploiement de plus de dix mille casques bleus.
C’est dans ce contexte que l’organisation s’apprête à célébrer en grande pompe son cinquantième anniversaire. Mais aux blessures non cicatrisées du passé s’ajoute aujourd’hui une sourde lutte d’influence entre les États qui aspirent à jouer les premiers rôles sur la scène diplomatique.
La laborieuse élection de la Sud-Africaine Dlamini Zuma au poste de présidente de la commission, l’année dernière, en est l’illustration. Désormais les "puissances" du continent ont pour objectif de siéger au Conseil de sécurité des Nations unies, le jour où cette instance sera réformée, sa composition élargie. Et dans cette perspective, tous les coups sont permis entre Sud-Africains, Nigérians, et Algériens notamment.
it
