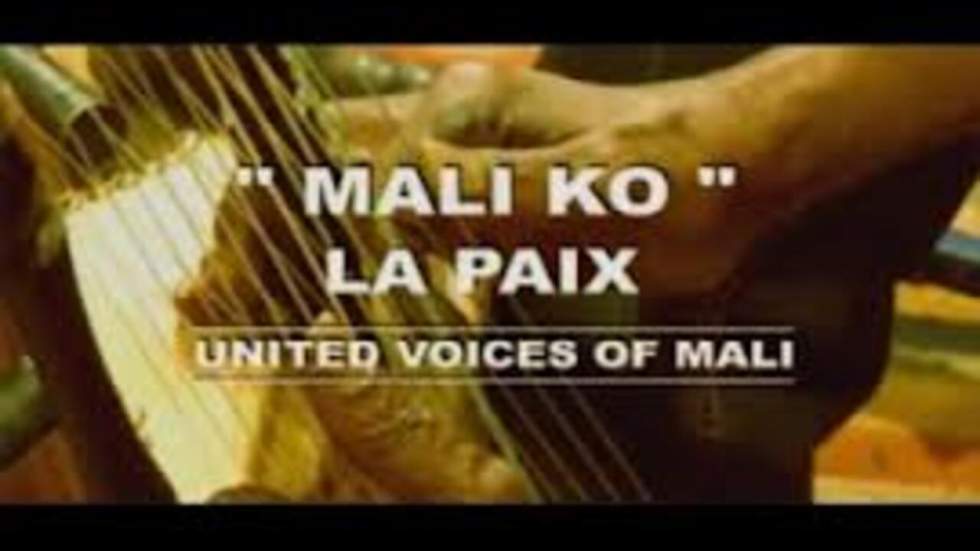
Difficile d’exercer son métier de musicien en temps de guerre, que ce soit dans le sud ou dans le nord du Mali. Les uns n’ont plus de concerts, les autres ont l’interdiction de jouer. Pourtant, la musique pourrait être un ciment de réconciliation.
"Mali-Ko", la paix au Mali. Quelque quarante musiciens et chanteurs maliens se sont enfermés dans le mythique studio Bologan de Bamako pendant trois jours pour enregistrer ce morceau-choral où chacun - de Fatoumata Diawara à Amadou et Mariam, de Vieux Farka Touré à Oumou Sangaré, de Toumani Diabaté à Khaira Arby - y va de son couplet pour appeler à l’unification du Mali et à la fin de la mainmise islamiste sur le nord du pays. "Je n'ai jamais vu de situation aussi désolante, catastrophique. Ils veulent nous imposer la charia. Allez leur dire que le Mali est indivisible mais aussi inchangeable", chante Soumaila Kanouté. "Faisons attention, pour ne pas perdre notre pays. Faites attention, sinon nos enfants et nos petits-enfants ne pourront pas lever la tête. Je m’adresse aux politiciens et aux militaires", renchérit Oumou Sangaré.
Après plusieurs mois de flottement face à une situation politique incertaine depuis le coup d’État de mars 2012, les musiciens maliens, nombreux et influents dans le pays, prennent ouvertement position. La diva du Mali, Oumou Sangaré, était la première à écrire une musique dédiée à l’unité de son pays. Elle témoigne, sur France Culture, fin décembre : "L’ambiance est morte, ça ne vit plus à Bamako. En tant qu’artiste, c’est dur. J’imaginais tout sauf la guerre". En juin dernier, elle a composé "La paix", qu’elle chante dans le monde entier. "Je me suis dis : 'Réveille-toi, c’est la réalité, fais quelque chose'. Et j’ai écrit une chanson, 'La paix', dans laquelle je chante : 'Je voyais la guerre dans les autres pays, j’entendais le coup de fusil dans les autres pays, j’imaginais jamais que cela se passerait un jour chez moi'."
Tiken Jah Fakoly - Ivoirien, mais qui a longtemps résidé à Bamako - sort ensuite, le 31 décembre dernier, un single "An ka willi" ("Mobilisation et galvanisation", en langue bambara). Dix jours plus tard, la tension entre djihadistes du Nord-Mali et l’armée régulière montait d’un cran.
Au Sud, "même les animations de mariage sont devenues rares"
Ces singles sont cependant des exceptions en des temps difficiles. Les musiciens du Sud-Mali n’arrivent plus à se produire sur scène. Les concerts sont annulés, par crainte qu’un rassemblement soit la cible des djihadistes. Et les opportunités de jouer de la musique se font rares. "Avant je pouvais faire cinq concerts par semaine. Maintenant, j'arrive à peine à en faire deux. Même les animations de mariage sont devenues rares", raconte la chanteuse Sadio Sidibé sur FRANCE 24.
Les musiciens sont également priés de ne pas aller trop loin dans la critique des autorités, qui préfèrent que les artistes fassent bloc autour de l’intervention militaire. Le rappeur Amkoullel a fait les frais de la censure lorsqu’il a sorti son morceau "SOS", le 2 juin dernier, dans lequel il clame : "Démocratie en papier / non non plus jamais ça / politiciens nous blaguer / fonds publics détournés / religion pour manipuler / non non plus jamais ça". Le single passe sur certaines radios privées, mais le clip n’est jamais diffusé sur la télévision nationale. "Ils auraient préféré un clip avec des fleurs et des oiseaux, pas des images d’armes et de pauvreté", ironise le chanteur, interrogé sur France Culture, fin décembre.
La menace vient parfois directement des islamistes, qui font la chasse à la tradition des griots. Le chanteur Salif Keita vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. "Je ne vais pas renier mes origines, ça ne serait plus moi. Ils vont me tuer, un coup de fusil et c’est fini. Je sais que je suis une cible", expliquait le griot albinos sur France Culture, le mois dernier.
Exil en Algérie, au Niger et au Burkina Faso
Dans le nord du Mali, la vie des artistes est également menacée. Interdits depuis août dernier de jouer des instruments, d’écouter de la musique, ou même d’avoir une mélodie pour sonnerie de téléphone portable, certains sont partis vivre à Bamako, d’autres ont trouvé refuge dans les camps de réfugiés au Burkina Faso et au Niger, d'autres encore ont choisi Tamanrasset, dans le sud de l’Algérie - plus proche et plus facile d’accès pour les Touareg que la capitale malienne.
Les musiciens touareg disent n’avoir plus le cœur à jouer. Le Festival au désert, l'une des chambres d’écho internationales de cette musique, qui se tient habituellement à Tombouctou, n’est pas certain de pouvoir se réunir, en février. "Là où sont les musiciens, à Bamako ou dans les camps de réfugiés, les opportunités sont rares. Ils sont complètement désœuvrés. Un tel festival peut leur redonner de l’espoir", veut croire cependant le directeur du festival, Manny Ansar, interviewé sur RFI.
Pour sauver coûte que coûte le Festival au désert, il est prévu que deux caravanes, l’une avec Oumou Sangaré, l’autre avec le groupe touareg emblématique Tinariwen, convergent vers Ouagadougou, fin février.
"Les seuls endroits où on peut encore entendre de la musique traditionnelle nord-malienne sont dans les camps de réfugiés", où des jeunes organisent des soirées, témoigne Arnaud Contreras, producteur à France Culture et spécialiste des cultures sahariennes, qui a pu rencontrer des musiciens au Burkina Faso (reportage à écouter sur RFI ci-contre). "Ils sont partis sans guitare mais avec leur téléphone portable. Ils écoutent toutes sortes de musiques maliennes en branchant leurs appareils sur des baffles, tournées vers le Mali."
Jouer ensemble, le nouveau défi
Interdite au Nord, la musique touareg n’est pas toujours la bienvenue au Sud. Elle est longtemps restée à part, ignorée des officiels à Bamako. Lorsque le groupe Tinariwen a reçu un Grammy Award, prestigieuse récompense musicale remise à Los Angeles, en février 2012, le ministère malien de la Culture n’a pas adressé un mot de félicitations. "Il y a une amertume face au manque de soutien moral de Bamako", note Arnaud Contreras. Ce producteur de radio remarque cependant que les lignes bougent.
En septembre dernier, au grand rassemblement pour la paix au Mali qui s’est tenu à Montreuil, ville à l’est de Paris où vit une importante communauté malienne, le guitariste et chanteur touareg Sidi Ag Issa, entouré de musiciens des groupes touareg Terakaft et Tamikrest, ont ainsi eu le cran de monter sur scène. "Il y avait un silence au départ. Puis la foule de 7 000 personnes est devenue très enthousiaste", se souvient Arnaud Contreras.
Dans les jours qui viennent, une tournée en Grande-Bretagne et en France réunira trois tendances de la musique malienne : Sidi Touré, qui joue de la musique songhaï, Bassékou Kouyaté, embassadeur du n’goni, et Tamikrest, groupe touareg qui mélange funk et tradition tamashek. Comme aime le dire Arnaud Contreras, la musique est un facteur d’unification du pays.
