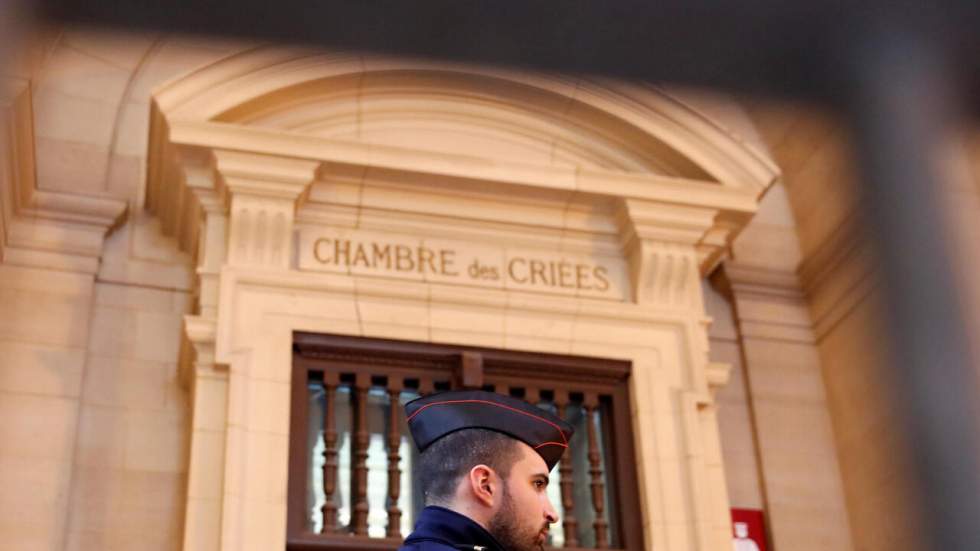
La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné, vendredi, dix-neuf "fantômes" jihadistes à des peines allant de 25 ans à la perpétuité. Ces prévenus pas comme les autres, car morts ou présumés morts, étaient jugés pour avoir rejoint les rangs du groupe État islamique en Irak ou en Syrie entre 2014 et 2015.
C'était l'heure du verdict d'un procès singulier. La cour d'assises spéciale de Paris a condamné, vendredi 17 janvier, 19 "fantômes" à des peines de prison allant de 25 ans à la perpétuité. Ces accusés, morts ou présumés morts, avaient rejoint entre 2014 et 2015 la zone irako-syrienne.
La plus lourde peine a été infligée à Mohamed Belhoucine, "figure tutélaire" dans ce procès et considéré comme le mentor d'Amedy Coulibaly, le tueur de l'Hyper Cacher (janvier 2015). Parmi les 18 autres "fantômes" de ce dossier, tous les hommes ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle, et quatre femmes à des peines de 25 et 28 ans.
Cinq vivants à la barre
Outre les "fantômes", cinq autres accusés, présents au procès, se sont vus infliger des peines allant de deux ans ferme, aménageables immédiatement, à 12 ans de réclusion. Des peines globalement inférieures à celles requises par l'avocat général, qui avait demandé 15 ans pour deux d'entre eux.
La cour n'a pas détaillé ses motivations. Le représentant du ministère public avait vu dans les "19 chaises vides" au procès l'illustration du "jusqu'au-boutisme" de ces jeunes Français, Marocains, Mauritaniens ou Algériens, partis à 20 ou 30 ans, pour "un voyage sans retour" et "en connaissance de cause dans un pays en guerre".
Parmi ces "fantômes", Quentin Roy, donné pour mort à 23 ans dans une opération suicide en Irak, le couple Faucheux, parti avec ses trois enfants, le prêcheur radical Sofiane Nairy ou les frères Belhoucine, personnages emblématiques du jihadisme francophone, qui seront à nouveau jugés au printemps au procès des attentats de janvier 2015.
Juger les morts
Quentin Roy fait partie d'un autre groupe, celui des "copains" de Sevran (Seine-Saint-Denis), qui se connaissent tous, ont fréquenté ensemble la mosquée des "Radars" où ils ont forgé leurs certitudes jihadistes notamment au contact de Sofiane Nairy - qui a connu Mohamed Belhoucine à l'école des Mines d'Albi.
Le jeune converti est le seul des "fantômes" à avoir bénéficié d'une défense, donnant au procès un relief inédit. "En France en 2020, on refuse de rapatrier les vivants, mais on juge les morts", a grondé à la barre Me Antoine Ory jeudi 16 janvier. Et d'expliquer le "paradoxe" qui consiste à "juger un homme qui s'est suicidé", dans une opération kamikaze, quand le droit français commande que les poursuites s'éteignent avec la mort du mis en cause.
Comme nombre des "fantômes", les "vivants" se sont convertis à l'islam radical à la mosquée de Sevran où ils se croisaient tous ou auprès de mentors. Leur défense a décrit la puissance de la "dynamique de groupe", mais aussi "la honte" ressentie face aux "paroles de haine" proférées il y a cinq ans, et le chemin parcouru en devenant père ou en décrochant un travail.
Un message entendu par la cour concernant les deux hommes comparaissant libres, qui n'iront pas en prison : tous deux ont été condamnés à deux ans ferme, immédiatement aménageables (avec port de bracelet électronique), et trois ans de sursis avec mise à l'épreuve (notamment une obligation de suivi psychologique).
Le plus lourdement condamné est Iliès Benadour (douze ans de réclusion), qui avait reconnu avoir "coordonné" les départs de ses "copains", désigné comme un maillon "essentiel" de la filière en France. Comme Yacine Bouhil, à ses côtés dans le box et brièvement parti, sa peine a été assortie d'une période de sûreté des deux tiers et les deux condamnés seront inscrits au fichier des auteurs d'infractions terroristes.
Avec AFP
